- Cheval Energy Academy
-
Téléconseil & Analyses Labo
Tous les produits Téléconseil & Analyses Labo
- Menu
- Nouveautés
-
Compléments
Tous les produits
Etat général- Tous les produits
- Huiles
- Vitamines, Minéraux
- Oligo-éléments
- Immunité
- Anémie
- Anti-Oxydants
Performance- Tous les produits
- Vitamines
- Boosters
- Electrolytes
- Récupération du cheval
Peau, Sabots- Tous les produits
- Biotine
- Pousse Poil, Corne
- Dermite, gale de boue
- Sarcoïdes, Verrues
- Fourbure du cheval
Respiration- Tous les produits
- Toux
- Emphysème
- Saignement à l'effort, HPIE
- Nébulisation
Cheval Senior- Tous les produits
- Vitamines
- Arthrose
- Cushing du cheval
- Immunité
- Reprise d'Etat
Naturels- Tous les produits
- Levure de bière
- MSM
- Collagène
- Miel
- Huile de lin
-
Phyto
-
Aliments, CMV
Tous les produits
Fourrages pour chevaux- Tous les produits
- Foins, granulés de foin
- Luzernes
- Enrubannés
CMV Ration- Tous les produits
- CMV Sport
- CMV Loisir
- CMV Sénior
- CMV Elevage
- CMV Course, Endurance
Friandises pour chevaux- Tous les produits
- Friandises
- Pierres à sel
- Accessoires
-
Soins
Tous les produits
Sabots- Tous les produits
- Fourchettes pourries
- Sabots secs, Graisses, Huiles
- Fourmilières, seimes
- Abcès
Argiles- Tous les produits
- Argiles
- Argiles chauffantes
- Argiles rafraichissantes
-
Pansage
Tous les produits
Brosses, Etrilles- Tous les produits
- Brosses, gants et éponges
- Cure-pieds, peignes
Tondeuses- Tous les produits
- Tondeuses classiques
- Tondeuses de finitions
- Accessoires
Nattage- Tous les produits
- Démêlants, lustrants
- Elastiques
- Autres accessoires
-
Equipement du cheval
Tous les produits
Chemises- Tous les produits
- Chemises séchantes
- Chemises de marcheur
- Chemises anti-insectes
- Chemises de box
-
Materiel vétérinaire, Equipement écurie
Tous les produits
Maréchalerie- Tous les produits
- Reinettes, rapes et pinces
- Autres accessoires
-
Briderie, Mors
- Marques
- Promos & DLUO courtes
-
Chien, Chat
Tous les produits
Rhinopneumonie et grippe équine : tout ce qu'il faut savoir
La rhinopneumonie et grippe équine sont deux affections virales. Elles sont spécifiques des chevaux et évoluent selon des modèles endémiques. Leur répartition est mondiale et représente un enjeu économique mais également sanitaire. Les atteintes de ces deux pathologies peuvent être : respiratoire, céphalique, génitale ou encore générale. Il existe à l’heure actuelle des mesures prophylactiques : les vaccins. Nous en détaillerons les aspects sur la santé et sur la réglementation pour les chevaux de concours notamment.
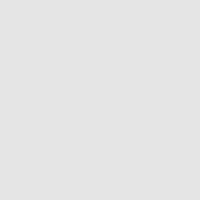
Les agents responsables de la rhinopneumonie et grippe équine
Les deux agents responsables sont des virus.
La rhinopneumonie équine
On recense à l’heure actuelle plusieurs souches responsables de la « rhino ». Ce sont des herpèsvirus, dont une de leur caractéristique est la latence. Il existe cinq souches : HVE-1, HVE-2, HVE-3, HVE-4 et HVE-5. Les souches HVE-1 et HVE-4 sont les plus « retrouvées ». HVE-3 est responsable d’une maladie génitale principalement, c’est l’exanthème coïtal, dont l’impact se retrouve plutôt en élevage. Nous détaillerons ici les souches HVE-1 et HVE-4.
- HVE-1 : Ce virus est responsable de formes nerveuses, respiratoires et abortives. Souvent en association avec le HVE-4. Il est comme de nombreux herpèsvirus, capable de latence et de réactivation en cas de stress notamment. La contagion est importante entre équidés. L’homme peut se retrouver vecteur mais ne sera jamais atteint (ce n’est pas une zoonose).
- HVE-4 : Ce virus est majoritairement responsable des formes respiratoires de la maladie. Il est également capable de latence au sein de l’organisme.
À l’heure actuelle, ce sont les deux types les plus retrouvés chez les équidés. De nombreux chevaux sont porteurs asymptomatiques (non malades). La rhinopneumonie selon un mode épizootique (épidémie) ou par cas isolés. Leur structure ne leur permet pas de subsister trop longtemps dans l’environnement ce qui conditionnera l’épidémiologie de ces virus.
La grippe équine
Le principal agent de grippe est également un virus. C’est un influenza virus de type A (EIV), proche du virus de la grippe humaine. Cependant aucune transmission n’est possible entre l’homme et le cheval. Comme tous les virus de la grippe, ils sont définis par des protéines de structures : les neuraminidases (N) et les hémagglutinines (H) d’où les appellations connues (H1N1, H5N3…). Ces protéines sont d’importance dans la pathogénicité du virus, nous ne détaillerons pas les spécificités de ces dernières (retenons juste que les deux types retrouvés chez le cheval sont H7N7 et H3N8). Il est néanmoins important de comprendre que sa structure est relativement fragile et que sa survie dans le milieu extérieur est également limitée. C’est ce qui sera à l’origine du mode de transmission.
Les modes de transmission des virus
Les virus HVE-1, HVE-4 et EIV sont des virus peu résistants dans l’environnement. Leur transmission est en partie dépendante de cette particularité. Dans le cas des herpèsvirus, il peut y avoir eu latence avant l’apparition clinique, la transmission a pu être inapparente. Plus généralement, pour les virus de la grippe et de la rhinopneumonie, elle est directe le plus souvent et s’effectue entre chevaux, au contact du matériel infectieux (sécrétions nasales, avortons, placenta, jetages liés à la toux). Elle peut aussi être indirecte et se faire par l’intermédiaire de l’homme et du matériel médical utilisé. Dans le cas des herpèsvirus, on peut suspecter une survie de quelques jours dans la paille et l’environnement induisant ainsi une transmission indirecte par le biais de l’environnement.
Les symptômes de la rhinopneumonie et grippe équine
La rhinopneumonie équine
- La forme « classique » : due aux virus HVE-1 (forme respiratoire) et HVE-4. Elle est caractérisée par une toux quinteuse, la présence de jetages, de l’hyperthermie ainsi que des larmoiements. Les jeunes chevaux en sont plus souvent victimes. L’issue est plutôt favorable bien que des complications bactériennes puissent survenir.
- La forme abortive : due essentiellement au virus HVE-1. Elle est définie par des avortements en fin de gestation ou une mort prématurée des poulains. Elle peut être récidivante. La jument cependant n’est pas cliniquement atteinte.
- La forme neurologique : induite par le virus HVE-1 également. Elle se caractérise par une atteinte grave de la mobilité des chevaux, de l’ataxie (chutes, pertes d’équilibre), une paralysie du pénis et l’absence de contraction vésicale. Cette forme est rare et non forcément corrélée à une atteinte respiratoire ou abortive.
La grippe équine
Trois formes sont classiquement retrouvées (notamment en fonction du statut vaccinal de l’animal) :
- Une forme mineure : elle est plutôt sub-clinique. On observera une hyperthermie non permanente, pas ou peu de toux, le jetage nasal restera assez faible et une adénomégalie (augmentation de la taille des nœuds lymphatiques) des nœuds lymphatiques laryngés. Cette forme est majoritaire chez les chevaux vaccinés.
- Une forme majeure : elle est plus grave. On identifiera une hyperthermie aiguë, un état fébrile, de l’anorexie ainsi que de l’abattement. Une forte toux, forte, sèche (en absence de complication bactérienne) et persistante de plusieurs jours à plusieurs semaines. Une congestion des muqueuses oculaire et nasale est observable. Des écoulements sont aussi notables. On observe une forte morbidité (nombre d’individus malades) mais une faible mortalité à l’exception des poulains.
- Une forme majeure compliquée : dans ce cas, soit les chevaux ont été fortement exposés à une charge virale importante, soit ils ont eu une complication bactérienne d’une forme majeure. Le jetage devient alors muco-purulent, on observera une forte hyperthermie, de la dyspnée (difficulté respiratoire) mais aussi de l’abattement. Des complications respiratoires du type sinusite, broncho-pneumonie ou encore bronchite sont à craindre.
Le diagnostic et les traitements de la rhinopneumonie et grippe équine
La rhinopneumonie et la grippe équine sont diagnostiquées à partir de différents prélèvements. Parmi eux : écouvillon naso-pharyngé, sang, produits d’avortement, sérum ou encore foie. Est ensuite réalisée une culture cellulaire permettant le développement du virus puis sa mise en évidence. À l’heure actuelle la méthode de choix est la PCR « polymérase chaine réaction » qui consiste à amplifier la séquence de matériel génétique d’intérêt. Cette dernière témoignera de la présence du virus si elle est amplifiée.
Concernant les traitements, qu’il s’agisse de la rhinopneumonie ou de la grippe équine (quelle que soit la forme), il n’existe aucun traitement spécifique. Dans tous les cas, un traitement symptomatique sera mis en place avec soutien des grandes fonctions dans les cas graves. Les objectifs seront de faire baisser la fièvre, de limiter la douleur et d’éviter des surinfections qui seraient un facteur défavorable à la guérison. Pour répondre à ces différents objectifs, on utilisera des AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) et des antibiotiques en cas de surinfections. Pour les formes nerveuses de rhinopneumonies, on peut être amené à soutenir les chevaux à l’aide de harnais. L’état des chevaux ne leur permettant pas de rester debout.
La prophylaxie et les mesures d’hygiène
À ce jour, des vaccins permettent une protection des équidés contre ces maladies.
Les vaccins contre la rhinopneumonie équine
Il existe des vaccins contre les types HVE-1 et HVE-4, ce sont des vaccins obligatoires pour les reproducteurs et les chevaux de concours et de courses. La primo vaccination consiste en deux injections à quatre ou six semaines d’intervalle puis un rappel avant six mois et ensuite un rappel annuel. Pour améliorer l’immunité il est recommandé de vacciner tous les six mois. Chez les juments gestantes la vaccination est recommandée aux deuxième, cinquième et neuvième mois après l’insémination.
Ce n’est pas un vaccin obligatoire en dehors des premiers cas cités, cependant le RESPE (réseau d’épidémio-surveillance en pathologie équine) le conseille.
Les vaccins contre la grippe équine
Il existe à l’heure actuelle un vaccin recommandé pour tous les chevaux en bon état général. Il est cependant obligatoire pour les chevaux participant à des évènements équestres (concours, courses…). Le protocole est réalisé en deux injections à trois et jusqu’à douze semaines d’intervalles puis une injection six mois après. Le rappel est annuel pour les chevaux en FFE, SHF ou en courses et pour les chevaux de FEI le rappel doit être fait dans les six mois précédant la compétition.
| Maladie | Protocole | Obligations réglementaires |
| Rhinopneumonie équine |
Deux injections à 4 - 6 semaines d'intervalle + rappel à 6 mois Ensuite rappel annuel |
Vaccination recommandée pour tous les équidés Obligatoire pour les reproducteurs, chevaux de course et de concours |
| Grippe équine |
Deux injections à 3 - 12 semaines d'intervalle + rappel à 6 mois Ensuite rappel annuel |
Vaccination recommandée pour tous les équidés Obligatoire pour les chevaux participants à des rassemblements
|
La mise en quarantaine
Il est possible voire conseillé de placer en quarantaine les équidés à l’introduction. Aussi en cas de doute ou d’affirmation d’un cas de rhinopneumonie ou de grippe équine, il faut placer les chevaux atteint à l’isolement. Éviter le contact avec les autres chevaux, éviter de toucher les autres chevaux après avoir touché les contaminés mais aussi désinfecter les locaux régulièrement. Il est fortement conseillé en cas d’épidémie (parfois même interdit) de bouger des chevaux même sains du foyer épidémique.
VOIR TOUS LES DÉSINFECTANTS SANITERPEN
Le kit d'urgence sanitaire Isobox contient tous les outils indispensables pour éviter le risque de prolifération de maladies au sein des structures équestres, en attendant l’arrivée du vétérinaire ou la mise en place d'une solution thérapeutique adaptée.
Il est possible de suivre l’évolution de ces maladies ainsi que de trouver des informations sur le site internet du RESPE.
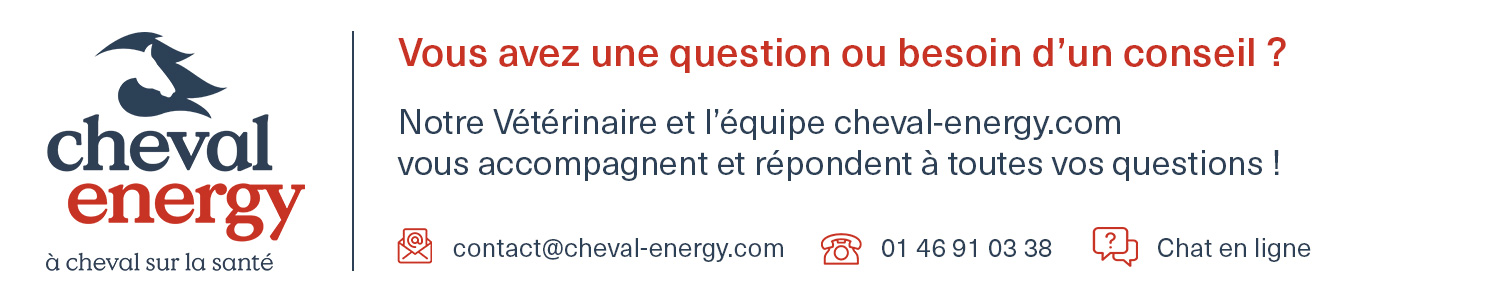
Voir d’autres articles
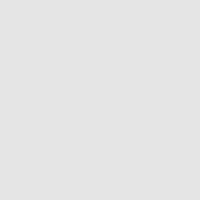 Ulcères gastriques du cheval : comment les prévenir
Ulcères gastriques du cheval : comment les prévenir
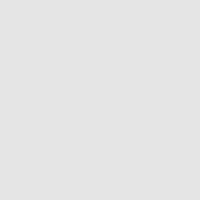 Colique du cheval : comment reconnaître, prévenir et réagir
Colique du cheval : comment reconnaître, prévenir et réagir
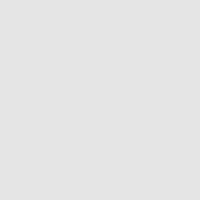 Coup de sang du cheval ou myosite : comment réagir
Coup de sang du cheval ou myosite : comment réagir
