- Cheval Energy Academy
-
Téléconseil & Analyses Labo
Tous les produits Téléconseil & Analyses Labo
- Menu
- Nouveautés
-
Compléments
Tous les produits
Etat général- Tous les produits
- Huiles
- Vitamines, Minéraux
- Oligo-éléments
- Immunité
- Anémie
- Anti-Oxydants
Performance- Tous les produits
- Vitamines
- Boosters
- Electrolytes
- Récupération du cheval
Peau, Sabots- Tous les produits
- Biotine
- Pousse Poil, Corne
- Dermite, gale de boue
- Sarcoïdes, Verrues
- Fourbure du cheval
Respiration- Tous les produits
- Toux
- Emphysème
- Saignement à l'effort, HPIE
- Nébulisation
Cheval Senior- Tous les produits
- Vitamines
- Arthrose
- Cushing du cheval
- Immunité
- Reprise d'Etat
Naturels- Tous les produits
- Levure de bière
- MSM
- Collagène
- Miel
- Huile de lin
-
Phyto
-
Aliments, CMV
Tous les produits
Fourrages pour chevaux- Tous les produits
- Foins, granulés de foin
- Luzernes
- Enrubannés
CMV Ration- Tous les produits
- CMV Sport
- CMV Loisir
- CMV Sénior
- CMV Elevage
- CMV Course, Endurance
Friandises pour chevaux- Tous les produits
- Friandises
- Pierres à sel
- Accessoires
-
Soins
Tous les produits
Sabots- Tous les produits
- Fourchettes pourries
- Sabots secs, Graisses, Huiles
- Fourmilières, seimes
- Abcès
Argiles- Tous les produits
- Argiles
- Argiles chauffantes
- Argiles rafraichissantes
-
Pansage
Tous les produits
Brosses, Etrilles- Tous les produits
- Brosses, gants et éponges
- Cure-pieds, peignes
Tondeuses- Tous les produits
- Tondeuses classiques
- Tondeuses de finitions
- Accessoires
Nattage- Tous les produits
- Démêlants, lustrants
- Elastiques
- Autres accessoires
-
Equipement du cheval
Tous les produits
Chemises- Tous les produits
- Chemises séchantes
- Chemises de marcheur
- Chemises anti-insectes
- Chemises de box
-
Materiel vétérinaire, Equipement écurie
Tous les produits
Maréchalerie- Tous les produits
- Reinettes, rapes et pinces
- Autres accessoires
-
Briderie, Mors
- Marques
- Promos & DLUO courtes
-
Chien, Chat
Tous les produits
Cheval naviculaire : comment prévenir et soulager
L’os naviculaire, ou sésamoïde distal, est un petit os aplati ayant une forme de demi-lune. Il répond à la deuxième phalange et s’articule avec la troisième. De par sa configuration, il présente une zone de glissement tendineux (pour le tendon fléchisseur profond notamment), cette zone est appelée le facies flexoria. Le syndrome naviculaire ou autrement appelé syndrome podotrochléaire correspond à des atteintes pouvant être variées dans la région palmaire du pied (incluant l’articulation interphallangienne distale et l’os sésamoïde distal). Rappelons que le terme distal signifie que l’on parle des extrémités au plus loin du thorax. Le cheval naviculaire est alors est atteint d'une boiterie chronique.
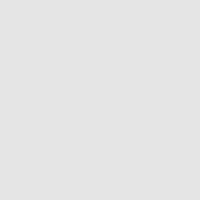
Caractéristiques morphologiques du doigt du cheval incluant l’os sésamoïde
Le doigt du cheval est composé de trois phalanges, respectivement P1, P2 et P3, ainsi que l’os sésamoïde. Concernant les tendons, on retrouve le tendon fléchisseur superficiel du doigt (FSD) dont la terminaison distale se fait sur P2 et le tendon fléchisseur profond du doigt (FPD) dont la terminaison se fait sur P3 (comme sur le schéma ci-dessus). Sur la partie arrière du pied se place le coussinet digital ayant pour rôle l’amortissement des chocs. L’os naviculaire est donc pour ainsi dire « noyé » dans ces structures, avec lesquelles il s’articule et permet le glissement du tendon fléchisseur profond. Sa stabilité est assurée par les ligaments (sésamoïdien distal et les collatéraux).
La mise en tension de cette zone du pied a lieu lors de l’extension du pied, cette dernière ayant lieu en phase postérieure. Mais qu’est-ce que la phase postérieure ? Pour l’expliquer il faut parler un peu de la locomotion. Une foulée est divisée en deux phases : la phase d’appui (composée de l’amortissement, du soutènement et de la propulsion) et une phase de soutien (composée du ramener, de la suspension et de l’embrassée). La phase postérieure correspond au reculer du membre, autrement dit au moment où le pied est encore au sol et induit la propulsion. Cette phase a lieu durant la phase d’appui. Lors de la propulsion, l’articulation du pied est à son maximum d’extension et les fibres tendineuses étirées. Pour le cheval naviculaire, cette phase est raccourcie, le cheval avance plus rapidement son membre, soit pour limiter l’appui au sol qui est douloureux soit à cause d’un lésion articulaire, osseuse, tendineuse ou encore mixte.
Définition d'un cheval naviculaire et les symptômes
Il est important de bien comprendre les rapports unissant les différentes structures au sein du pied. En effet, un syndrome podotrochléaire ou naviculaire peut être multi factoriel (dans la majeure partie des cas), ou n’atteindre que la partie tendineuse ou ligamentaire : ligament sésamoïdien distal, les collatéraux ou encore le tendon fléchisseur profond (rappelons que ce dernier coulisse sur le facies flexoria, surface osseuse de l’os sésamoïde). Il n’est pas moins impossible d’observer une atteinte de la bourse naviculaire (située entre l’os naviculaire et le tendon fléchisseur profond du doigt), une atteinte articulaire ou une atteinte osseuse (kystes ou sclérose = densification de l’os). Ce syndrome naviculaire se situe dans la face palmaire du pied et peut avoir un impact fonctionnel non négligeable.
Les symptômes chez le cheval naviculaire apparaissent progressivement, la boiterie peut être intermittente, le cheval tente de soulager son membre, d’une part en raccourcissant sa foulée postérieure mais aussi par des placers de son pied « en avant » à l’arrêt. On observe une aggravation de la boiterie sur un cercle à main correspondante sur un sol dur, les foulées postérieures sont aussi raccourcies sur les huit de chiffre. Une baisse de performance notamment à l’obstacle n’est pas rare, cela est lié au fort amortissement à la réception qui induit une extension importante du pied.
Les éléments du diagnostic du cheval naviculaire
Test de la planche
Lors d’une suspicion de maladie naviculaire chez le cheval, différentes étapes mènent au diagnostic. Parmi elles on retrouve le test caractéristique de la planche : il consiste à mettre le pied en hyper extension et ainsi déclencher (ou non) une réaction. Si le cheval réagit, il y a de fortes chances qu’une atteinte podotrochléaire soit présente. Pour exécuter ce test, le vétérinaire place le pied du cheval sur l’extrémité d’une planche et il la soulève depuis l’autre extrémité ce qui induit une mise en extension artificielle du pied. Un examen statique et dynamique est réalisé avec les tests de flexion, souvent positif. Le test de flexion correspond à une flexion manuelle du membre, si le cheval refuse la flexion statique ou déclenche une boiterie sur le membre fléchit après un départ au trot, la probabilité d’une atteinte peut être importante.
Imageries
L’imagerie est également un outil de choix pour diagnostiquer le cheval naviculaire. On réalise communément trois radios, une latéro-médiale et deux obliques. Elles permettent de visualiser l’os sous différents angles et de s’affranchir de certaines superpositions. On peut y observer les fossettes du naviculaire ainsi que l’état du facies flexoria. Afin d’observer les tissus mous on peut avoir recours à l’échographie. Néanmoins par cet intermédiaire nous n’avons pas accès à toutes les structures internes du pied. L’IRM est également un examen possible, permettant d’observer toutes les structures du pied.
Anesthésies tronculaires
Afin d’établir le diagnostic d’une maladie podotrochléaire, il est nécessaire d’avoir recours à une anesthésie digitale distale (donc de l’arrière du pied), qui consiste à endormir le nerf digital de l’arrière du pied. Si l’anesthésie est positive, c’est-à-dire qu’il y a une amélioration de la locomotion, il est possible de conclure à une maladie du naviculaire chez le cheval.
L’incidence d’une pathologie naviculaire sur le plan sportif
Lors d’une pathologie du naviculaire il est important de prendre en compte que la carrière sportive du cheval va s’en trouver limitée. Un travail léger est préconisé afin de maintenir la vascularisation du pied (bien entendu sous accord vétérinaire), sur terrain souple et en ligne droite. Il est même bon pour le cheval de marcher pour conserver le fonctionnement du pied, une bonne vascularisation et une bonne production cornée. Les aplombs peuvent avoir un impact dans cette pathologie.
Il est possible d’adapter la ferrure à cette maladie notamment en utilisant des fers spécifiques, qui peuvent réduire les tensions exercées lors de la phase propulsive (phase douloureuse lors d’une pathologie naviculaire). En effet ces fers limitent l’enfoncement du talon, repartissent le poids plus uniformément. Il est aussi possible de travailler sur l’angulation du pied (conserver un bon alignement des phalanges), toujours dans l’optique d’améliorer la mobilité et de maintenir une bonne activité de la pompe vasculaire du pied (essentielle à sa bonne santé). Chaque cheval étant différent, l’adaptation de la ferrure est donc individu dépendant. Il est possible que le vétérinaire et le maréchal ferrant travaillent conjointement pour déterminer par radio les besoins correctifs pouvant être apportés par le fer.
D’un point de vue médical, il est envisageable, lors de crises, de soutenir le cheval par un traitement basé sur l’administration d’AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) pour ce qui est de l’aspect général. Mais il est possible d’avoir recours à des infiltrations intra articulaires ou dans la bourse naviculaire.
Il arrive également d’avoir recours à la chirurgie pour traiter des stades très avancés. L’opération consiste à sectionner le nerf digital distal (celui qui est visé lors des anesthésies tronculaires). Cependant cette chirurgie élimine la douleur sans traiter la cause, cela nécessite une surveillance régulière du pied.
N’oublions pas qu’il est possible de soutenir la fonction locomotrice grâce à des compléments alimentaires du type Chrysanphyton (favorisant une bonne circulation sanguine dans le pied) ou encore des produits du type Artphyton pour le soutien de la fonction articulaire.
Biomécanique avancée de l'appareil podotrochléaire
L'appareil podotrochléaire constitue un système biomécanique complexe dont la compréhension est essentielle pour appréhender le syndrome naviculaire. La position anatomique de l'os naviculaire lui confère un rôle de poulie de renvoi pour le tendon fléchisseur profond, créant ainsi un point de compression naturel. Cette configuration particulière explique pourquoi certains chevaux développent plus facilement une maladie naviculaire.
Lors de la phase d'appui, la force exercée sur l'os naviculaire peut atteindre jusqu'à 4 fois le poids du cheval. Cette contrainte mécanique importante s'accentue particulièrement dans certaines disciplines comme le saut d'obstacles ou le concours complet, où les réceptions multiplient ces forces. Le syndrome naviculaire résulte souvent d'une accumulation progressive de ces micro-traumatismes.
Facteurs de risque et prédispositions raciales
Les chevaux de sport présentent une prédisposition particulière au développement du syndrome naviculaire. Les races comme le Quarter Horse, le Pur-sang et le KWPN montrent une incidence plus élevée, possiblement en raison de leurs caractéristiques morphologiques et de leur utilisation sportive intensive. Les éléments prédisposants incluent :
-
Une conformation avec des talons fuyants
-
Des pieds étroits et contractés
-
Un travail intensif sur sol dur
-
Un déséquilibre médio-latéral du pied
Les avancées en matière de diagnostic
Le diagnostic du syndrome naviculaire bénéficie aujourd'hui des progrès de l'imagerie médicale. L'IRM debout représente une avancée majeure, permettant d'observer avec précision les tissus mous sans nécessiter d'anesthésie générale. Cette technique révèle des lésions précoces de l'os naviculaire et des structures adjacentes, offrant la possibilité d'intervenir avant l'aggravation des symptômes.
La scintigraphie nucléaire constitue également un outil diagnostique performant. Elle met en évidence l'activité métabolique osseuse, identifiant les zones de remodelage actif caractéristiques de la maladie naviculaire. Cette technique s'avère particulièrement utile pour les cas difficiles à diagnostiquer par radiographie conventionnelle.
Approches thérapeutiques innovantes
La prise en charge du cheval naviculaire évolue constamment. Les thérapies par ondes de choc focales montrent des résultats encourageants, stimulant la régénération tissulaire et réduisant l'inflammation. Cette approche non invasive complète efficacement les traitements conventionnels.
L'utilisation de la médecine régénérative, notamment le PRP (Plasma Riche en Plaquettes) et les cellules souches, ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques. Ces traitements, injectés dans la bourse naviculaire ou l'articulation interphalangienne distale, favorisent la réparation tissulaire et limitent l'inflammation chronique.
Gestion quotidienne du cheval naviculaireLa gestion quotidienne d'un cheval naviculaire requiert une approche méthodique et rigoureuse, combinant plusieurs aspects essentiels. Le programme d'exercice constitue la pierre angulaire du management, nécessitant une mise en route progressive de 15 à 20 minutes au pas sur sol souple, idéalement sur piste en sable fibré. L'échauffement doit inclure des lignes droites à 80% du temps, en limitant les cercles à un diamètre minimum de 20 mètres. Le travail monté s'effectue préférentiellement en reprise individuelle pour contrôler précisément les allures et éviter les changements brusques de direction. Les séances ne dépassent pas 45 minutes, avec une alternance de phases de travail et de repos, en privilégiant le pas et le trot. Le galop s'introduit progressivement, uniquement sur sol régulier et après un échauffement complet.
La gestion environnementale joue un rôle crucial : le cheval naviculaire bénéficie d'un paddock individuel avec un sol stabilisé, drainant, dépourvu d'ornières et de dénivelés importants. La surface idéale combine sable et copeaux sur une profondeur de 10-15 cm, permettant un amortissement optimal sans créer d'instabilité. Le box, quant à lui, nécessite une litière généreuse de 15-20 cm, régulièrement entretenue pour maintenir un support confortable et absorbant. L'aménagement inclut un tapis caoutchouc anti-dérapant devant le point d'alimentation, réduisant les contraintes lors des stations prolongées.
Le suivi podal s'organise selon un calendrier strict : parage toutes les 4-6 semaines en fonction de la pousse, avec une attention particulière à l'équilibre médio-latéral et antéro-postérieur. La ferrure orthopédique, ajustée par radiographie, privilégie des fers à traverse large (minimum 25mm) pour les antérieurs, avec rolling en pince et supports aux talons. L'état des pieds fait l'objet d'une inspection quotidienne, incluant un nettoyage approfondi et l'application de produits hydratants sur la paroi et la fourchette. Les membres sont systématiquement protégés lors des déplacements avec des guêtres ou des bandes de travail adaptées.
L'alimentation s'adapte pour maintenir un poids optimal, évitant toute surcharge pondérale qui aggraverait les contraintes biomécaniques. La ration, fractionnée en 3-4 repas quotidiens, incorpore des compléments spécifiques soutenant la fonction articulaire et la vascularisation du pied. L'hydratation fait l'objet d'une surveillance particulière, avec un accès permanent à une eau propre et tempérée, favorisant une bonne circulation sanguine périphérique.
Cette gestion s'accompagne d'un monitoring constant des signes cliniques : température des pieds, qualité des aplombs au repos, régularité des allures au début de chaque séance. Un carnet de suivi détaillé permet de noter les observations quotidiennes, les adaptations de ferrure, les traitements administrés et l'évolution des performances, constituant un outil précieux pour le vétérinaire lors des contrôles bimestriels.
| Domaine | Actions quotidiennes | Fréquence de contrôle | Points de vigilance |
| Exercice |
Échauffement 15-20 min au pas |
Quotidien | Qualité des allures Signes de fatigue Réaction post-effort |
| Ferrure | Inspection des fers Nettoyage des pieds Application soins hydratants |
Quotidien pour inspection 4-6 semaines pour ferrure | Usure des fers État de la corne Équilibre du pied |
| Hébergement | Vérification sol paddock Entretien litière box Contrôle surfaces |
Quotidien | Absence d'ornières Drainage Confort support |
| Surveillance clinique | Température des pieds Qualité des aplombs Position au repos |
Quotidien | Chaleur anormale Modifications posturales Signes de douleur |
Prévention et suivi à long terme
La prévention du syndrome naviculaire s'appuie sur plusieurs piliers fondamentaux. Une attention particulière doit être portée à la qualité des sols d'entraînement, en privilégiant des surfaces souples mais stabilisées. La gestion du pied constitue un élément clé, avec un parage régulier maintenant l'équilibre du pied.
L'apport de compléments alimentaires spécifiques comme le Chrysanphyton de Equistro favorise une bonne vascularisation du pied. En complément, l'Artphyton soutient la fonction articulaire, particulièrement sollicitée chez le cheval naviculaire.
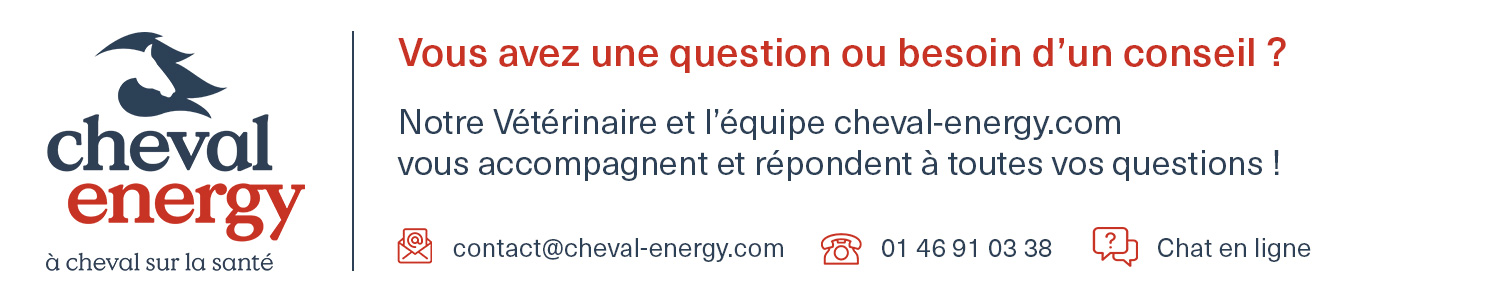
Voir d’autres articles
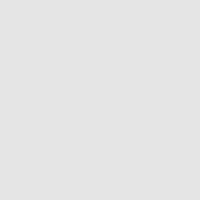 Ulcères gastriques du cheval : comment les prévenir
Ulcères gastriques du cheval : comment les prévenir
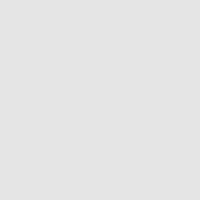 Colique du cheval : comment reconnaître, prévenir et réagir
Colique du cheval : comment reconnaître, prévenir et réagir
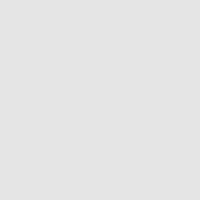 Coup de sang du cheval ou myosite : comment réagir
Coup de sang du cheval ou myosite : comment réagir

